Consommation responsable au Québec : entre volonté de changement et fatigue écologique
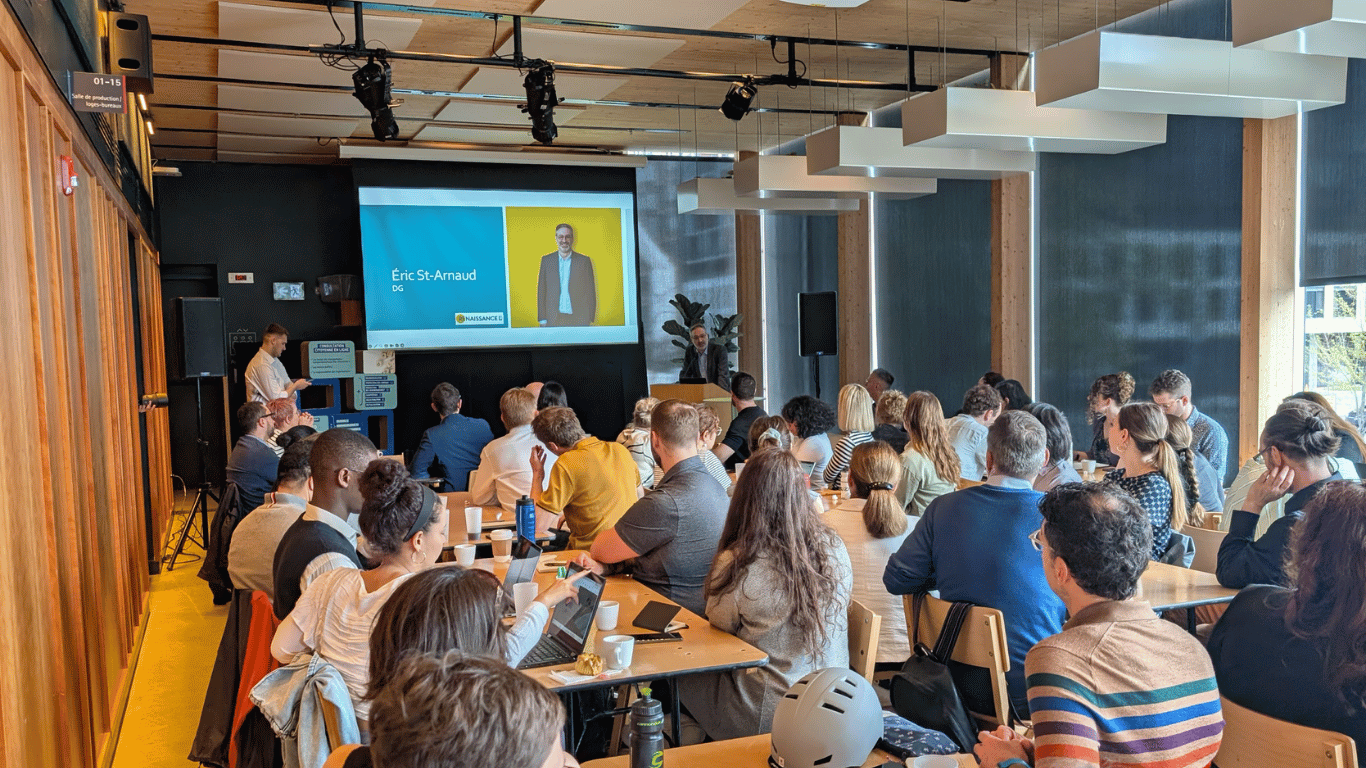
Montréal, le 7 mai 2025 – L’édition marquant les 15 ans du Baromètre de la consommation responsable, menée par l’Observatoire de la consommation responsable (OCR) de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, en collaboration avec Renaissance et Recyc-Québec, dresse un bilan lucide, nuancé et révélateur des comportements des Québécoises et Québécois. Si la consommation responsable s’ancre progressivement dans les habitudes, elle reste confrontée à des tensions majeures : impact du coût de la vie, écofatigue ambiante, perte de repères collectifs et contradictions à surmonter. Dans ce contexte, une question s’impose : comment faire évoluer nos habitudes sans alourdir davantage le quotidien?
Des gestes en progression, mais encore freinés
Selon le Baromètre, 86,7 % de la population québécoise affirme consommer de manière responsable. Pourtant, seulement 18,7 % des répondants se disent être des consommateurs réellement engagés. Plusieurs facteurs freinent le passage à l’action, notamment les contraintes financières, la complexité des choix à poser ou encore un certain découragement devant la surcharge de responsabilités individuelles.
Certaines pratiques gagnent en popularité — l’usage de gourdes, de sacs ou de tasses réutilisables devient courant — mais d’autres, comme l’achat en vrac, restent marginales, freinées par des obstacles logistiques ou une offre peu accessible.
La seconde main en voie de normalisation
Malgré ces freins, des signaux encourageants émergent. L’achat de seconde main, par exemple, devient un réflexe partagé. Une personne sur dix affirme acheter des objets usagés au moins une fois par semaine, et deux sur trois déclarent que cela leur permet de limiter l’achat de biens neufs. Ce geste simple traduit une forme de sobriété choisie et accessible — une manière de consommer autrement, sans nécessairement consommer moins.
Une sobriété volontaire, mais raisonnée
58,8 % des personnes interrogées disent avoir réduit leur consommation au cours de la dernière année. Si cette tendance s’explique en partie par l’inflation, elle révèle aussi un recentrage sur l’essentiel. La population québécoise semble prête à faire des compromis, mais sans sacrifier la qualité de vie : on ajuste, on sélectionne, on cherche à préserver une forme de bien-être malgré les contraintes.
Des attentes redéfinies envers les marques
Alors que les discours environnementaux peinent parfois à mobiliser, les attentes envers les marques évoluent. L’utilité sociale, la solidarité et la réponse aux enjeux économiques prennent le pas sur les promesses strictement écologiques. Ce glissement est visible dans les résultats du Baromètre : les marques les plus appréciées sont désormais celles qui proposent des solutions concrètes au quotidien, en particulier dans les domaines du réemploi, de l’économie circulaire et de l’inclusion.
Entre saturation et méconnaissance
Le Baromètre met également en lumière une forme de saturation. Près de 40 % des répondants estiment en faire déjà assez pour la planète. Un tiers se sent découragé devant la complexité des gestes à poser ou la tonalité anxiogène de certains messages. Par ailleurs, plus de 75 % reconnaissent ne pas bien connaître l’impact environnemental de leur consommation, et très peu utilisent des outils d’évaluation à cet effet.
Des modèles qui inspirent autrement
Dans ce contexte de lucidité et de fatigue, des modèles hybrides trouvent écho auprès de la population. Qu’il s’agisse de consommer autrement, de prolonger la durée de vie des objets ou de donner plutôt que jeter, les solutions qui conjuguent impact social et environnemental sont perçues comme plus accessibles, plus humaines et plus ancrées dans la réalité. Des organisations comme Renaissance, actives depuis 30 ans dans l’économie circulaire et la réinsertion socioprofessionnelle, incarnent ce type d’approche pragmatique et solidaire. Elles rappellent qu’on peut faire une différence, sans culpabilisation ni perfection, mais à partir de gestes concrets, collectifs et inclusifs.
Et demain ? Une responsabilité collective à réinventer
Les Québécoises et Québécois continuent de croire à une responsabilité partagée. Une grande majorité d’entre eux considère que c’est avant tout aux individus de jouer leur rôle dans cette transition, avec 75,7 % qui le pensent, mais les entreprises, les détaillants, les gouvernements, les acteurs sociaux et les groupes environnementalistes sont aussi perçus comme essentiels à cette équation. Toutefois, l’évolution des attentes envers ces acteurs montre un recul marqué par rapport aux années précédentes. Ce phénomène suggère qu’il existe une réelle demande de renouvellement du contrat social écologique, un besoin de nouvelles approches qui répondent davantage aux attentes actuelles.
Les gestes que la population souhaite prioriser dans l’année à venir sont des actions simples et accessibles, que l’on peut facilement intégrer à son quotidien. Plus de 76 % des répondants se disent prêts à réduire leurs déchets à la source, tandis qu’une proportion similaire veut trier davantage. D’autres gestes comme la réduction du plastique (75,7 %) ou l’achat local (72,5 %) continuent de séduire. Ces gestes ne sont pas seulement à l’échelle individuelle, car des mesures collectives recueillent aussi un large soutien, notamment l’encadrement des invendus, la gratuité des transports collectifs ou des incitatifs fiscaux pour l’achat de biens écoresponsables. Près de 70 % des Québécois souhaitent que les gouvernements prennent des mesures plus concrètes en matière d’environnement.
Une invitation à faire front commun
Le Baromètre 2025 met en lumière les contradictions entre les bonnes intentions et la réalité des comportements. Malgré une forme de saturation face aux enjeux écologiques, des solutions simples mais significatives continuent de rassembler. Pour des organisations comme Renaissance, actives dans l’économie circulaire et la réinsertion professionnelle, cela confirme l’importance d’agir à la fois sur le plan social et environnemental. Ces résultats nous rappellent que la consommation responsable n’est pas seulement une affaire d’individus : il est essentiel de créer des solutions concrètes et accessibles à tous. En réconciliant gestes personnels, engagements collectifs et politiques publiques, nous pouvons franchir une nouvelle étape ensemble.


